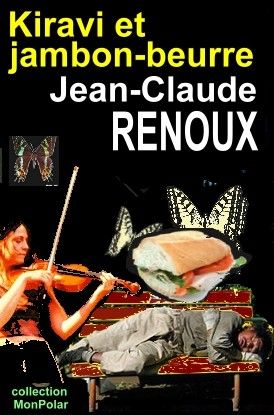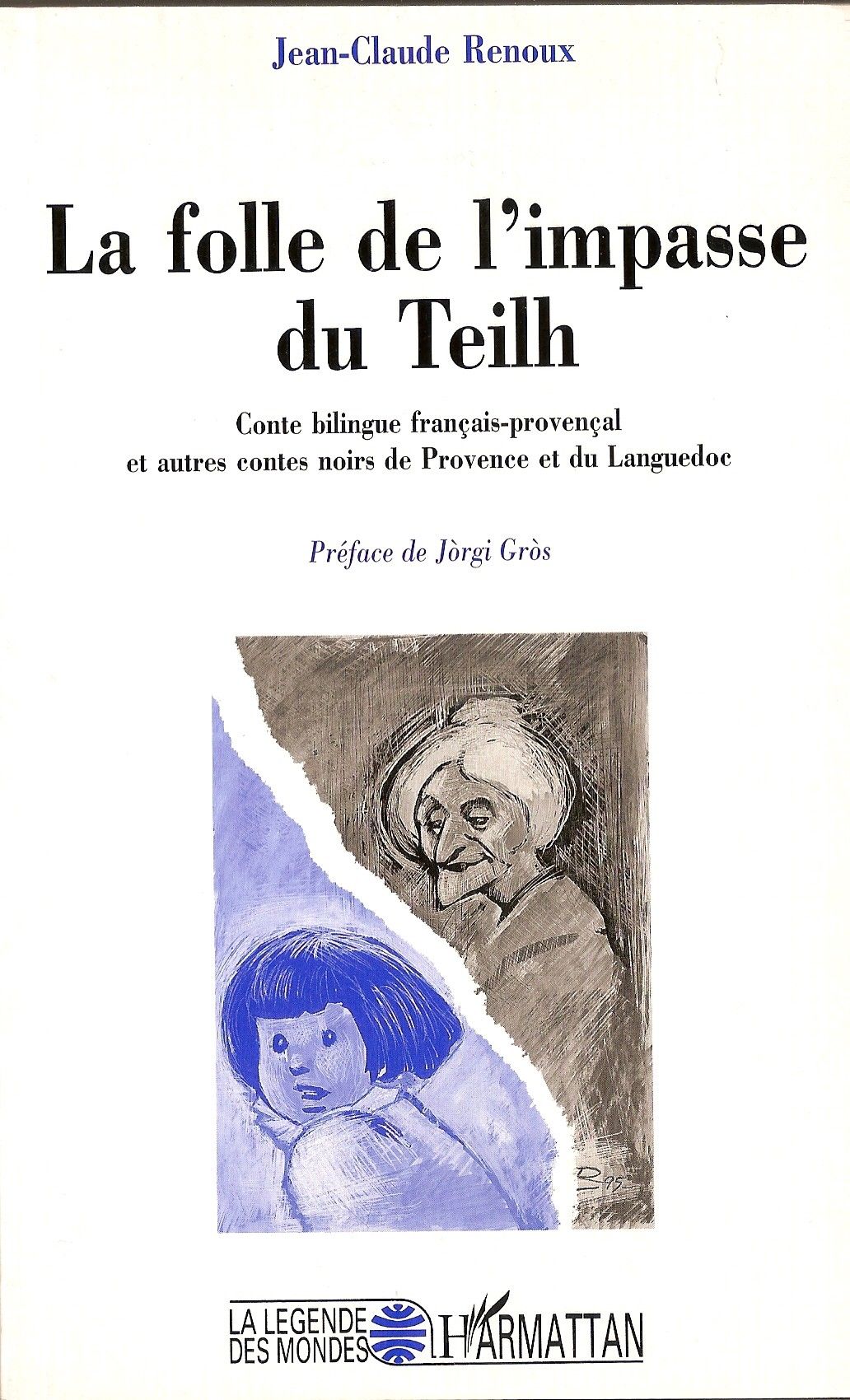air amis animal animaux argent background belle bleu bonne centerblog chat cheval
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· 10 - Contes pour adultes (42)
· 07 - Tout-public, ados, grands enfants (38)
· 15 Contes de Noël (10)
· 05 - tout petits (26)
· 06 - contes traditionnels (48)
· 11 La nuit de la mandrette (7)
· 04 - La noix babou (3)
· 09 - Le conte du montreur d'ours (8)
· 13 la passion selon saint Roch (7)
· 16 Théâtre (16)
j'adore le conter, les enfants sont ravis de reprendre en cœur, pauvre ... il était tout mouillé, il avait
Par Anonyme, le 20.12.2021
merci infiniment pour ce magnifique conte
Par Anonyme, le 30.11.2021
superbe
Par Anonyme, le 21.05.2021
du génie
Par Anonyme, le 09.05.2021
excellent
Par Mohand, le 10.04.2021
· Contes pour adultes et contes
· Contes tout-public, ados et grands-enfants
· La galette des rois
· Le plus gros gros mot du monde
· La véritable histoire du père Noël
· comptine hérisson
· Le Noël des animaux
· Accueil
· Introduction au conte pour tout-petits
· Comment je me suis débarrassé de ma belle-mère
· Le petit caca
· La princesse fleur
· Le Noël du 68
· La corrida
· Le Noël de la fée proprette !
· lapetitequivoulaitlesmontagnes
Statistiques
Date de création : 28.10.2008
Dernière mise à jour :
19.01.2024
227 articles
10 - Contes pour adultes
L'ennemi de l'intérieur
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Retour à la page "contes noirs et pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
Jean-Claude RENOUX
nimausus@orange.fr
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
L’ennemi de l'intérieur
Au début de son mariage monsieur Thỏ n’avait pu que se féliciter de son choix : madame Thảo était une épouse modèle, bonne cuisinière, même si en ces temps-là il y avait peu et si elle devait faire pour le mieux avec ce peu-là, toujours de bonne humeur, attentive au moindre désir de son époux.
Et puis l’ennemi était rentré dans la maison. L’ennemi c’était la télévision. Et madame Thảo s’était avérée accro aux feuilletons coréens. Tôt le matin et jusque tard dans la nuit l’ennemi diffusait ces abominations que Monsieur Thỏ détestait. Il ne pouvait plus écouter la musique populaire traditionnelle dont il raffolait. Elle restait rivée à son fauteuil, fascinée par l’ennemi qui diffusait son venin à longueur de journée. Madame Thảo en négligeait tous ses devoirs de cuisinière, de ménagère et d’épouse et elle était devenue une mégère acariâtre qui ne supportait pas d’être interrompue dans ce qui était maintenant sa seule activité. Monsieur Thỏ en était réduit à manger sur le trottoir où il cantinait désormais. Et son travail s’en ressentait. Il n’était pas rare qu’il s’endorme dans le bus où il vendait les billets. Les conducteurs se plaignaient et monsieur Thỏ craignait de perdre son emploi, jusqu’au jour où en rentrant il trouva madame Thảo morte devant la télévision, victime d’une overdose de feuilletons coréens.
Monsieur Thỏ fêta comme il se doit l’évènement, c’est-à-dire qu’il invita la parentèle, les voisins, les collègues de travail à l’enterrement et l’on fit ripaille pendant plusieurs jours avant de conduire madame Thảo jusqu’à sa tombe provisoire. Monsieur Thỏ paya même un orchestre qui joua Cát Bụi et du jazz vietnamien, convia tous les bonzes et bonzesses du village, et loua trois cars.
Cent jours après le décès, monsieur Thỏ cessa de déposer de la nourriture sur l’autel, conformément à la tradition.
Il pensa revendre la télévision. Monsieur Thỏ allait enfin être un veuf heureux !
Mais une nuit monsieur Thỏ poussa un hurlement de douleur : quelqu’un lui avait mordu le gros orteil. Il pensa d’abord à un rat mais son cri se transforma en un hurlement de terreur en reconnaissant madame Thảo, ou plutôt son fantôme, qui pointa un doigt osseux vers lui en hurlant :
- Je veux écouter la télévision…
Et la vie de monsieur Thỏ redevint un enfer : le fantôme se manifestait à n’importe quelle heure de la nuit en réclamant d’écouter un feuilleton débile. Monsieur Thỏ en perdit et le sommeil et l’appétit, mais il patienta jusqu’à la fête des âmes errantes, le Têt Thất Tịch. Il fit confectionner une superbe télévision en papier votif, il prit même soin d’y faire peindre par le calligraphe de la rue Hai Bà Trưng « made in Korea ». Le quinzième jour du septième mois lunaire il brûla la télévision et vit avec soulagement la fumée gagner le ciel et la télévision rejoindre madame Thảo. Cette fois monsieur Thỏ était libre. Du moins le croyait-il. Car la nuit même quelqu’un lui croquait de nouveau le gros orteil et une voix aigre lançait :
- Et la télécommande ?
Fable de la mi automne
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
nimausus@orange.fr
Retour à la page "contes noirs et pour adultes"
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
Fable de la mi automne.
Cette nuit-là personne ne dort dans le village de Bên Nghiêng. Le quinzième jour du huitième mois lunaire c’est la fête de Trung Thu, la fête de la mi automne. Conformément à la tradition, on a mangé en famille les gâteaux de lune en buvant du thé. Les enfants ont envahi les rues avec leurs lanternes. Les paysans quant à eux scrutent la lune. Si elle est lumineuse les récoltes seront abondantes. Si elle a des reflets jaunes, les vers donneront beaucoup de soie. Si l’éclat en est vert, alors la disette s’invitera à Bên Nghiêng. Et si des trainées noires la ternissent, alors la guerre déferlera sur les campagnes.
Les jeunes filles ont d’autres préoccupations. Toujours selon la tradition, la nuit est propice aux révélations du vieil homme sous la lune qui s’occupe dès la naissance des mariages arrangés. Elles se glissent donc dans les jardins et cherchent à tâtons le légume qui leur donnera quelques indications sur leur condition de future épousée.
Voilà pourquoi cette nuit-là on peut voir la silhouette de trois demoiselles avançant à croupetons dans le jardinet de la mère Rúa.
Mademoiselle Thứ Hai est la première à s’exclamer en palpant à pleines mains une énorme courge :
- Celui à qui mes parents me destinent est donc joufflu du derrière. Assurément c’est bien le fils du boucher.
Mademoiselle Thứ Ba fait part à son tour de sa découverte. À vrai dire elle est à la fois admirative et un peu dégouté par l’odeur de la paire de durians qu’elle soupèse.
- Houlà, le mien est un couillu qui se néglige, je devrai lui apprendre à se laver. À l’odeur, je reconnais bien là le fils du maître d’école…
Quant à Mademoiselle Thứ tự elle éclate en sanglots en lâchant le crapaud que le hasard vient de placer sous ses doigts et qui vient de coasser :
- Hélas, ce qui m’attend est couvert de pustules et il rote en bavant. Assurément c’est le fils du chef de village qui étudie à la capitale. Il aura attrapé une mauvaise maladie en fréquentant certaine auberge qu’on dit bien pourvu en renardes qui s’ingénient par leurs maléfices à détourner de leurs études les étudiants argentés !
Et mademoiselle Thứ Tự de pleurer sous la lune alors que ses amies rêvent, l’une à son joufflu du derrière et l’autre à son couillu malodorant du devant.
La fille du roi du fleuve
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
nimausus@orange.fr
Retour à la page "contes noirs et pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
La fille du roi du fleuve
Il était une fois un jeune homme qui s’appelait Trung. Ce jeune homme était studieux et il s’était révélé un étudiant prometteur, si bien que ses parents, de riches commerçants, l’avaient envoyé au chef-lieu de la province pour y préparer le concours qui ferait de lui un lettré, et lui permettrait de concours en concours d’accéder aux plus hautes fonctions.
Trung logeait avec d’autres étudiants une modeste auberge non loin des remparts, et le temps qu’ils ne passaient pas à l’étude, ils le consacraient à se promener le long du fleuve en discutant de choses et d’autres.
Or un jour un cheval noir s’en vint caracoler à côté d’eux. Aucun n’osa le chevaucher, mais durant une semaine le cheval semblait attendre leur venue, il sortait dont ne sait où, et les accompagnait dans leur promenade. Si bien qu’au bout d’une semaine, Trung décida de voir si la bête accepterait sa présence sur son dos et l’enfourcha. À peine Trung en selle, le cheval partir à vive allure et galopa des heures durant jusqu’à une prairie non loin du fleuve où une jeune fille, vêtue d’une tunique longue de la meilleure soie noire, faisait paître des moutons noirs. Elle lui sourit et lui dit :
- Je t’attendais, je m’étais promis d’épouser l’homme qui oserait monter mon cheval, et si tu en es d’accord il te faudra demander à mon père.
Sache d’abord que je ne suis pas une bergère comme les autres, je suis la fille du roi du fleuve, et les moutons que tu vois là sont les moutons de la pluie : que mon père me l’ordonne, pour cela j’entendrai le courant me transmettre sa volonté, et je soufflerai sur quelques bêtes qui s’envoleront, deviendront nuages avant de se répandre en pluie là où bon semblera au ciel…
La fille plaisait tant au jeune homme qu’il accepta de l’épouser et lui demanda comment faire sa demande auprès du père. La jeune fille lui indiqua un arbre non loin de là :
- Frappe cet arbre trois fois avec ta ceinture, et les eaux du fleuve s’ouvriront pour te laisser le passage et te permettre d’accéder au palais de mon père.
Ainsi fut fait, Trung gagna le palais du roi du fleuve, qui l’accepta de bonne grâce pour gendre, et quand Trung revint auprès de sa belle, un palais magnifique se dressait tout à côté de la prairie où paissaient les moutons.
Ils y vécurent heureux. Une foule de serviteurs s’empressaient à satisfaire le moindre de leur désir.
Or à la lisière des bois se trouvait une tombe, et dans cette tombe reposait une ancienne courtisane qui de son vivant prenait plaisir à entraîner les jeunes gens de bonne éducation dans la débauche pour les abandonner ensuite ruinés et désespérés. Elle en avait conduit plus d’un au suicide. Cette courtisane avait le pouvoir de reprendre vie à nuit tombée. Et c’est ainsi qu’elle avait pu voir le jeune couple se promener à la clarté de la lune et qu’elle s’était promise de séduire le jeune époux. Un beau soir où la fille du roi du fleuve avait rendu visite à son père et devait passer la nuit dans le palais du fleuve, la courtisane frappa à la porte du palais de Trung et prétendit s’être perdue. Elle implora qu’on lui accordât l’hospitalité. Elle fit tant et si bien, déploya tant de charmes et tant d’esprit que Trung succomba à la tentation et qu’ils s’endormirent dans les bras l’un de l’autre. Juste avant que les première lumières du jour n’adviennent un cri terrible les réveilla en sursaut. La fille du roi du fleuve les yeux exorbités regardait le couple enlacé. Elle courut jusqu’à la prairie et se mit à souffler tant et plus sur les moutons noirs qui s’envolèrent, après quoi elle frappa l’arbre, les eaux s’ouvrirent et elle regagna le palais de son père pour toujours. Il ne restait du palais des deux jeunes gens que la façade, et ce qui avait été une habitation animée n’était plus qu’un terrain vague envahi par les herbes folles. Les serviteurs avaient disparu en même temps que le palais devenait ruine. Trung couché au milieu des broussailles s’aperçut horrifié qu’il tenait dans ses bras la momie desséchée d’une femme.
Puis l’orage se déchaina, il plut tout un long mois, de jour comme de nuit, le fleuve grondait. Quand enfin le ciel se fut calmé, Trung vit que l’arbre magique s’était desséché. Transi et affamé il vit venir à lui le cheval noir. Sans un mot il l’enfourcha, et le cheval prit le galop pour ne plus s’arrêter.
On dit que les soirs d’orage ceux qui ont l’oreille exercée peuvent entendre derrière le bruit de la pluie et du tonnerre le galop d’un cheval. C’est Trung et sa monture, Trung condamné à galoper jusqu’à ce que la fille du roi du fleuve veuille bien lui pardonner.
Le chat de l’empereur
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
nimausus@hotmail.fr
Retour à la page "contes noirs et pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
Le chat de l’empereur
À voir sur YouTube
cliquer ici : le chat de l'empereur
Ngày xửa ngày xưa, c'est ainsi que commencent les contes au Vietnam. En ce temps-là nul homme n’avait le droit de séjourner dans le palais de l’empereur la nuit, hormis l’empereur lui-même, les eunuques, et les femmes, épouses, concubines, odalisques ou servantes…
Or donc, il y avait un jeune étudiant nommé Thui qui vivait à Hạ Nòi, du temps où la ville s'appelait Thăng Long. Cet étudiant préférait la débauche à l’étude. Un soir où Thui avait bu plus que d’ordinaire il jura qu’il passerait toute une nuit dans le palais de l’empereur, et la vantardise fit le tour de la ville, pour parvenir enfin aux oreilles de l’empereur qui éclata de rire et dit que si l’étudiant Thui parvenait à passer toute une nuit dans le palais, lui, l’empereur, promettait de se faire couper les ngọc quý (les précieuses.
Une nuit, Thui fut réveillé par un fantôme :
- Garçon, dit le fantôme, figure-toi que j’étais un haut fonctionnaire de la cour et que l’empereur d’humeur badine a eu la mauvaise idée de me faire couper la tête après que l’on m’eut fait subir le supplice du dépeçage. Aussi je ne serai pas mécontent de voir l'empereur perdre ses ngọc quý. Je vais t’indiquer un petit bois non loin de la capitale où poussent des roseaux dorés. Que tu brûles ces roseaux et que tu t’enduises de leurs cendres et tu deviendras invisible. Il te sera ensuite facile de rentrer dans le palais, et de décrire quelle robe l’empereur portait cette nuit-là pour qu’il se sente obligé de tenir se faire couper les ngọc quý !
Au matin Thui se rendit dans le petit bois. Là il y avait une source d’eau pure où nageaient des petits poissons d’or et dans les roseaux environnants gazouillaient des petits oiseaux d’argent. Thui fit brûler les roseaux, s’enduisit un doigt de cendre : le doigt disparu pour réapparaître une fois lavé dans l’eau de la source. Thui revint à la capitale avec un sac rempli de cendre, et l’après-midi-même après s’être entièrement dévêtu il se recouvrit de cendres et traversa ainsi la ville, nu comme un ver sans que personne ne le vît, s’introduisit dans le palais. Thui gagna ensuite la chambre de l’empereur, et après avoir bien observé la robe de ce dernier il sortit faire quelques pas dans le jardin en attendant l’ouverture des portes…
Thui n’avait pas pensé que la rosée pourrait délaver la cendre !
Si bien qu’aux premières lueurs du jour on découvrit un homme nu errant dans les jardins. Quel émoi ! On courut appeler l’empereur qui se voyait déjà perdre ses ngọc quý (précieuses) !
C’est alors qu’une idée vint à Thui : il se mit à quatre pattes et se mit à miauler ! Aussitôt l’empereur dit :
- Đó là một con mèo !
- C’est un chat !
Et comme personne n’osait contredire l’empereur, on acquiesça !
- D’ailleurs je vais m’en assurer moi-même, dit l’empereur !
Il s’approcha de Thui et le gratta derrière la tête tout en lui glissant dans l’oreille :
- Sais-tu que je pourrais te faire castrer, le chat ?
Et Thui ronronna :
- Sais-tu que je pourrais dire que je suis un homme et que tu y perdrais aussi tes ngọc qúy, mon maître ?
L’empereur se redressa vivement :
- Đúng rồi, đó là một con mèo !
- C’est bien un chat !
Voulant l’humilier tout en gardant ses ngọc quý, il ajouta aussitôt :
- Qu’on lui donne du lait, du poisson cru, et des souris, et qu’on reconduise ce chat dans sa demeure. Et pour qu’il ne lui arrive rien en route j’ordonne que dix hommes d’armes ouvrent la marche et que dix autres marchent derrière.
Et c’est ainsi que Thui dut avaler de bon matin du lait, du poisson cru et des souris, qu’il dut traverser la ville à quatre pattes, dix hommes d’armes par devant, dix hommes d’armes par derrière, tout en miaulant et nu comme un ver.
Un héraut criait à tue–tête :
- Faites place au chat de l’empereur, faites place au chat de l’empereur !
Thui resta cloitré tout le restant de la journée, de crainte des tueurs que l'empereur ne manquerait pas de dépêcher. À nuit tombée il s'enduisit de cendres et disparut. Et comme il connaissait l'existence du petit bois aux roseaux dorés, il ne connut jamais la faim et à défaut d'être bachelier il devint le prince des voleurs.
Quant à savoir s'il s'introduisit de nouveau de nuit dans le palais de l'empereur, aucune épouse, concubine, odalisque, ni même la moindre servante ne s'en est jamais vanté !
Xin hết, ainsi conclut-on les contes au Vietnam !
Le miracle de l'enfant aux oiseaux
Pour aller à l'accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
25, rue de l'aspic
30000 Nîmes
Tel 04 66 21 42 65
Contes pour adultes et contes noirs :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
Le miracle de l'enfant aux oiseaux
Qui me croira quand je dis aujourd’hui que c’est par le plus grand des hasards que ce texte m’est tombé entre les mains ? C’est pourtant la stricte vérité : il y a peu, je m’intéressai à un conteur du XVIème siècle qui vécut quelque temps à Uzès, un conteur que je découvris dans l’excellent livre que Gaston Chauvet consacra à cette ville ; je voulus en savoir plus, je cherchai ça et là dans les bibliothèques ; je n’y trouvai que des références allusives, à la traduction incertaine ; jusqu’au jour où j’obtins, sans vraies difficultés, l’autorisation de fouiller les archives de la Garde-Pradeilhes, où mon conteur était né, avait vécu, composé la plupart de ses oeuvres maîtresses en occitan. Les portes de la salle des archives de la tour de l’évêque de la Garde-Pradeilhes s’ouvrirent pour moi ! Je désespérais de trouver quoi que ce soit, quand je découvris une Bible du XIVème ; j’en admirais les enluminures ; dans la béance ouverte par la tranche en gouttière de la Bible ouverte, une pelure tremblotait légèrement ! Elle vint facilement sous le doigt. Il s’agissait d’un manuscrit recto-verso, couvert d’une écriture si fine, si serrée, que le parchemin en paraissait brunâtre ! Je n’ai pas la prétention de lire couramment le latin, d’autant que le texte était émaillé de vieux français et d’ancien occitan ; j’en savais assez pour comprendre, en parcourant le texte, que je venais de tomber sur un document comme aucun conteur, voire aucun historien, n’ose plus rêver en découvrir un jour ! Il me fallut trois mois pour déchiffrer les deux pages, et combien de difficultés : je compulsai nombre d’ouvrages, je téléphonai jusqu’en Belgique, jusqu’au Canada, lorsque l’écueil me paraissait insurmontable ; les amis lettrés auxquels je m’adressai ne tardèrent pas à comprendre toute l’importance de ma découverte, partageant mon enthousiasme, mes angoisses ; je menai jusqu’à son terme ma quête... Trois mois de travail acharné, trois mois pendant lesquels je ne dormis guère que deux à trois heures par nuit, trois mois où il m’arriva plus d’une fois de buter toute une journée sur le sens d’un même mot, trois mois d’exaltations, de désespoir... Trois mois pendant lesquels il ne me fut pas possible de découvrir l’identité véritable de l’auteur, qui vécut apparemment deux siècles environ avant mon conteur !
Trois mois ! À toi lecteur de juger si l’oeuvre en valait la peine !
Par Dieu, ce qui suit est vrai, je puis en attester, moi qui en fus acteur en un temps où, jeune clerc, j’étais au service de Monseigneur de P., évêque de la Garde-Pradeilhes ; j’en fus l’acteur et le témoin direct, tout au moins pour ce qui concerne ce qui se fit durant ma présence en cette ville ; pour ce qui s’ensuivit, après ma fuite, après ma pénitence, les témoignages concordants que j’en eus, par des gens que je connus pour gens honnêtes, me convainquent que ce qui s’en est dit est vrai aussi ; cela n’est d’ailleurs pas plus incroyable que ce que j’en vis moi-même !
Je me souviens de ce matin où, du haut de ma mule, je découvris la Garde-Pradeilhes, chatte rouge hérissée dans sa corbeille, quillée sur un chaos de pierres fadasses, de chênes bancroches, de redouls gris, de figuiers mauves ; à ses pieds, les eaux noires du Val d’Arifon, miroir de l’insondable, captaient le regard sans rien mirer ; je me retournai, à mi-côte : l’océan de garrigues bleues mourait jusqu’à se fondre dans l’eau du ciel ; un Jean-le-blanc glissait sur l’air, avec de temps en temps l’éclair bref, bleu, d’une rémige pour le rapprocher insensiblement, orbe après orbe, de sa proie ; la Garde-Pradeilhes m’apparut encore, au détour de la tortille qui menait à elle, belle, fière, drapée dans des dentelles de pierres cramées de soleil ; ce jour-là je songeai que ce sont des moments comme ces moments-là, des pas comme ces quelques pas-là, qui vous mènent droit au ciel... Aujourd’hui je sais, après que l’on m’eut ramené à elle pour mourir en son sein, je sais que s’il fut un jour en ces murs un juste, un élu, je n’étais pas celui-là !
Que diront les siècles à venir de Monseigneur de P. ? L’Histoire retiendra-t-elle son nom ? Moi qui le connus, je puis dire que ce n’était point un méchant homme, mais un homme pieux, qui avait fait don de sa personne à l’Eglise : qu’on l’enviât, que lui-même prospérât, c’est Elle que l’on admirait ! Il n’était que rondeur et, pourvu que l’on voulût bien le caresser, le flatter, plutôt accommodant. Il me prit en affection ; il fut pour beaucoup dans mon élévation d’esprit ! Grâce à lui, j’appris à connaître ceux avec qui il fallait compter, comment les traiter selon leur condition... Chacun de ceux qui se disputaient une parcelle de l’âme ou du corps de la Garde-Pradeilhes avait sa tour - je ne parle pas ici de ces tourettes d’angle que les nobliaux de l’endroit, les ennoblis, se hâtent d’ériger à l’entour de leur hôtel ; je parle des quatre doigts dédaigneux pointés vers le ciel, de ces poings terribles prêts à frapper les ruelles puantes et les larves qu’elles cachent : la tour des consuls, la tour de l’évêque, la tour du vicomte... La plus grande d’entre elles était en construction ; ce n’était que fouillis de charpentes, d’étais, de palans, de palplanches, de palis, de cordes, de poulies, grouillement de besogneux ; on discernait, là-haut, les loges des maçons que l’on montait, que l’on démontait au fur et à mesure que l’ouvrage filait : la tour du roi affirmait le nouveau pouvoir du parti français ! Dès potron-jacquet, quelquefois jusqu’à nuit noire, les ruelles résonnaient du charroi des blocs de pierre et des fustes ; les beuglantes, les priapées des ouvriers portaient haut, loin ; le ventre du chantier dévorait le coeur de la ville, pour le plus grand profit des tavernes de la cité, pour celui de l’Abbesse du mas des bagasses qui prospérait hors les murs et à qui les consuls payaient obole ; un chantier grand bâfreur d’impôts, dont les suppôts étaient redoutés des menuts quand leurs fillettes devaient braver la rue à nuit faite : plus d’une fut forcée, pour sa plus grande honte, plus d’une qui se tut de crainte de ne pouvoir ensuite trouver mari pour la battre et l’engrosser ; quant aux malheureuses qui en conçurent enfanton, elles grossissaient les rangs des fillettes du mas des bagasses et engraissaient la cassette de l’Abbesse... À la Garde-Pradeilhes, chaque place avait sa clientèle, ses courtisans, ses geôles, son bourreau, ses gens d’armes, ses sicaires ; chaque parti s’attachait ses lettrés, ses docteurs, pétris de patristique, prompts à la recension, habiles à filer la métaphore, à alterner parabole, allégorie, menace voilée, experts dans l’art de la prétérition, de la prolepse, de la prosopopée, tous gens capables de tout dire à mi-mots, sachant entretenir une rumeur, défaire quelque réputation que ce fût au mieux des intérêts de la partie représentée. Je devins un des leurs, et des meilleurs, oeuvrant pour la plus grande gloire de Monseigneur et de l’Eglise ; je n’y avais point grand mérite : le plaisir pris à jouer de l’intrigue, de la rhétorique, de la dialectique me payait largement du peu de peine que j’en prenais ; un plaisir qui élève l’âme, sans rien de comparable avec celui, bestial, avilissant, du vin, des femmes, des viandes pour lequel je n’éprouvais que dégoût ; j’en oubliai jusqu’aux nobles motifs qui me firent embrasser la robe ! Le crime civilisé dépure ! Je jure devant Dieu, à l’heure de mon supplice, n’avoir jamais commis, ni vu commettre de si grands crimes, ou observé tant de cruauté voilée - civilisée - que lorsque j’oeuvrais pour la plus grande gloire de Monseigneur de P.
Les prétextes à réjouissances sont rares ; s’il est une chose sur laquelle chacun s’entendait à la Garde-Pradeilhes, pauvre ou nanti, c’était que justice fût rendue, et connue ; du temps où j’étais érudit gagé, le bon usage voulait que l’on suppliciât trois condamnés chaque jour au mas de justice ; il n’y avait guère que les jours fériés où le gibet chômât et que l’on n’y pendît point quelque mauvais bougre... Vous comprendrez dans quel embarras se trouvèrent les consuls, quel scandale ce fut pour la cité, lorsque le bruit courut que parmi les prochains condamnés se trouvait Soubeyrol-le-jeune, fils de Soubeyrol-l’aîné notre premier consul. En certaines cités les membres du consulat avaient obtenu du roi, pour eux-mêmes et leurs descendants, de n’être point soumis à la question, ni suppliciés, sauf crime de lèse-majesté et, cela s’entend, tout autre crime touchant à la religion ; à la Garde-Pradeilhes, point de traité de cette sorte, la fillette profanée appartenait à la Place, le nouveau viguier, représentant du roi, entendait affermir son emprise sur la ville : les intérêts immédiats du parti français exigeaient que l’on sacrifiât le propre fils du premier des magistrats : Soubeyrol-le-jeune serait pendu ; les aléas de la politique voulaient aussi que l’Evêché et les bourgeois s’alliassent, s’épaulassent, sous quelque prétexte que ce fût, pour contrer les appétits du nouveau pouvoir montant ; il semblait opportun, à l’un, aux autres, que le viguier perdît la face ; l’affaire était d’autant plus digne d’intérêt qu’elle tournerait à notre avantage pour nous donner prise sur le consulat !
Monseigneur de P. se concerta avec Soubeyrol-l’aîné, en la grand-salle de la trésorerie. Plus grand d’une tête que le commun des hommes, franc d’épaules, de tête, d’idées, Soubeyrol-l’aîné était une brute grise, de teint, de poil, de caractère. ( J’imaginais ainsi les moines-soldats dont le roi Philippe, au début du siècle dernier, extirpa l’engeance du pays français après la chute du royaume de Jérusalem. ) Riche par devoir, non par appétence, il plaçait la cause des bourgeois, sa charge de consul, au-dessus de tout, for son fils et son honneur ; moins intelligent que déterminé, Soubeyrol-l’aîné inquiétait plus, comme l’orage ou le loup, qu’il n’était craint, respecté, comme chef. Issu d’une fratrie de douze, Soubeyrol-le-jeune seul avait survécu ; notre premier consul supplia mon maître de lui trouver quelque arrangement qui lui permît de sauver la vie de son sybarite de fils ( Cruelle alliance, que celle du loup et du berger : le loup s’était fait chien ; qu’on lui passât collier, il était perdu ! ). Monseigneur de P. réfléchit, en se caressant les mains qu’il avait longues, fines, soignées, comme il le faisait d’ordinaire lorsqu’il était dans l’embarras ; il se tourna vers moi, pour me commander d’extraire de sa cellule un certain lettré reclus depuis quinze ans dans les geôles de l’Evêché ; celui-là avait été condamné comme apostat après avoir accepté, du temps où la gent juive souillait la cité, de dîner avec l’un d’eux ... L’homme ne tenait plus debout sans aide ; on avait dû, de crainte qu’il n’arrivât point vivant à l’hôtel de la trésorerie, lui bander les yeux pour lui éviter d’être mortellement navré par la lumière du soleil... ( Il ne se passa pas un jour, depuis quarante ans, sans que je ne revisse le visage de cet érudit qui lisait en son temps aussi aisément le latin, le grec, l’hébreu, l’arabe, la langue d’oc et le français ; un visage mangé par la souffrance, les privations ; l’ironie qui en émanait montrait qu’il avait conservé beaucoup de ses facultés, de ses humanités ! ). Monseigneur de P. lui conta l’affaire ; il indiqua à notre évêque dans quel registre, à quelle date, il trouverait un décret royal accordant à tout condamné le privilège d’être gracié s’il se trouvait quelqu’un qui acceptât d’endurer le supplice à sa place. Monseigneur lui demanda s’il voulait, contre quelque menu avantage de dernière heure, être pendu demain ; l’autre savait en venant jusqu’ici mourir avant que le soleil ne fût couché, c’était bien la seule grâce qu’il acceptait de nous ; il ne nous offrirait pas le plaisir de se sacrifier pour - ce furent ses propres mots - un vermineux de l’âme !
Monseigneur de P. nous congédia, Soubeyrol et moi : il s’en remettait à nous pour trouver quelque accommodement que ce fût, pourvu qu’il existât ! Nous restâmes longtemps silencieux, en l’hôtel Soubeyrol, tournant, retournant dans nos têtes les derniers événements. Qui serait assez fou pour accepter d’être pendu à la place d’un autre ? À ma grande honte, je ne sais plus par quel obscur méandre de la pensée, c’est moi qui ai songé à l’enfant aux pigeons ! Chacun connaissait sa figure d’ange ; en ce pays de noirauds au teint recuit par le soleil, par le commerce avec les Maures ; il avait le cheveu blond, le teint rose, de grands yeux bleus candides, un sourire de perpétuelle innocence troussait ses lèvres douces. Un ange bâtard, orphelin d’une fillette du mas des bagasses morte en lui donnant le jour ; un ange qui avait poussé comme il avait pu, aidé par certains qui ne comptaient pas parmi les plus riches de la Garde-Pradeilhes ; un ange qui puait, qui se prenait pour un oiseau, qui charriait son nid en même temps que l’on déplaçait les loges, tout en haut de la tour du roi ! On ne lui connaissait pas d’autre nom que celui de Niaï. Les besogneux le toléraient : il ne dérangeait pas, rendait de menus services ; ces hommes seuls, aux appétits grossiers, l’aimaient d’amour chaste. Il roucoulait, perpétuellement couvert de fiente et de pigeons avec lesquels il partageait son pain, ne rêvant que d’une chose : prendre son vol, survoler la ville, plus haut que la plus haute des tours !
L’artifice fut vite conçu : tête d’ange ou pas, elle ne contenait jamais qu’une cervelle d’oiseau ! Quelques minutes plus tard nous marchions à grands pas vers la tour du roi. Soubeyrol-l’aîné titubait en escaladant la poutraison. Je craignis que le vertige ne l’emportât, qu’il ne s’écrasât sur la place du roi. Il faut croire que l’amour paternel donne de l’assurance : il se reprit ; il prit pied derrière moi sur la travée marquant le faîte de l’ouvrage. Ni le Niaï, ni les pigeons ne daignèrent tourner la tête pendant que j’exposais l’affaire afin de la rendre intelligible pour son esprit dérangé. Il m’écoutait pourtant ; lorsque j’eus fini, il parla, sans me regarder : « Je volerai ? - Je te le promets ! - Par le Jésus ? » Un abîme s’ouvrit en moi ; je répondis sans que ma voix ne fléchît : « Par Dieu, je le jure ! » Il me crut, pour mon plus grand malheur !
Soubeyrol-l’aîné était absorbé par la flambée qui rubéfiait la grand-salle de la maison des consuls. Un moment, je le pris pour le Diable ! Durant le trajet et depuis notre arrivée, il n’avait pas prononcé un mot ; son grand corps s’était tassé, il était plus gris que jamais, indifférent ; il me laissait toute initiative. À mon commandement, on dressa la table ; on prépara un lit pour le Niaï. Il mangea de petit appétit, emplissant ses poches de nourriture pour ses pigeons. Il souriait, ravi de tant d’attention ; il disait, de temps à autre : « Je volerai ? - Je te le promets ! - Par le Jésus ? » Il me regardait bien en face, en confiance ; je souriais et répondais sans que ma voix ne tremblât : « Par Dieu, je le jure ! » Je défendis qu’on lui servît à boire autre chose que de l’eau ; on le menât coucher. Il parlait dans son sommeil : « Je volerai ? » Je répondais doucement, en caressant ses cheveux blonds : « Par Dieu, je te le jure ! » Au matin, on le lava, on le parfuma, on l’habilla de propre, de neuf ; on l’introduisit dans la grand-salle où j’étais censé préparer le philtre destiné à le faire voler. Le malheureux n’avait jamais bu de vin ; je lui arrachais le pichet aromatisé, de crainte qu’il ne s’endormît et ne roulât sous la table. Le rituel voulait qu’à trois reprises, devant les consuls et le condamné assemblés, un clerc lui posât la même question : « Acceptes-tu, de ton plein gré, de prendre la place de cet homme ? » Trois fois il répondit : « Je volerai ? » Par trois fois, je me parjurai: « Par Dieu, je te le jure ! » Personne ne trouvant à redire quant au bon déroulement de la cérémonie, je déclarai enfin : « Qu’il en soit ainsi ! » Soubeyrol-l’aîné s’avança, baisa le Niaï sur la bouche. La pensée m’effleura alors de certain qui s’en était lavé les mains ! Je détournai la tête, les autres aussi ; Soubeyrol-le-jeune ricana !
On lui lia les mains ; il me regarda. « C’est pour ne point voler trop tôt ! » Hilare, il questionna la foule : « Je volerai ? » Ce ne fut qu’un grand rire, des cris : « Vole, l’oiseau, vole ! » Le peuple entier se pressait sur son passage ; le menu peuple des besogneux, des miséreux, des famineux, des déclassés du pays profond, étrangers de la montagne, qui survivait de tout, de rien, de charité, se disputant les plus rudes travaux pour un cruchon de vin, un quignon de pain... Le peuple, et les autres : les nobliaux, les marchands, les religieux par confréries ... « Je volerai ? - Vole, l’oiseau, vole ! » Le ventre de la ville, énorme, puant, se répandait en marée loqueteuse, informe, terrible : un ulcère de pouilleux, couvert de vermine, de plaies, où se mêlaient les braçiers, les vagabonds, les portefaix, les insensés, les mendiants, les vieillards de quarante ans, les édentés de quinze, les fausses vierges de trente, les prostituées qui n’avaient point encore de seins... « Je volerai ? - Vole, l’oiseau, vole ! » Les raccommodeurs de vêtements, d’escabeaux, de huches, les polisseurs d’étain, les marchands de chandelles, de vieilles chaussures, de vieux habits, de vaisselles cabossées ou ébréchées ; tous se pressaient, se gaussaient... « Je volerai ? - Vole, l’oiseau, vole ! » Ils étaient là, pour tuer le temps, les tueurs de taupes, de rats, d’ennui, de chiens, de chats, encombrant la chaussée, nous contraignant à marcher dans le caniveau central, parmi les immondices, la merde, le sang caillé, l’urine... « Je volerai ? - Vole, l’oiseau, vole ! » Jusqu’à la foule des enfants crasseux, vêtus de loques, petits cadavres en sursis, chaussés de chiffons huileux... « Je volerai ? - Vole, l’oiseau, vole ! » Sur l’estrade, sous le dais tendu au mas de justice, avaient pris place le vicomte, l’évêque, le viguier qui enrageait d’avoir été joué, les gens de la Place , les grandes dames apprivoisées qui pouffaient de la farce derrière le mouchoir brodé aux armes de leur mari... « Je volerai ? - Vole, l’oiseau, vole ! »
Les deux larrons qui seront pendus ce jour-là n’attendaient plus que lui ; on les hissa sur les échelles... Le Niaï comprit quand Jacquet le crapoussin, qui avait l’office d’aide-bourreau, prit place sur ses épaules... Il hurla, longuement ; tous se turent, enfin dégrisés... J’étais damné !
Il plut trois jours ; une trouée d’azur déchira le ciel gris, un unique rayon vînt frapper le gibet, le corps du Niaï... On vit en la ville de la Garde-Pradeilhes grand miracle : les pigeons, les corneilles des quatre tours de ville s’en vinrent voleter autour du supplicié, déchiquetant non les chairs, les yeux, le nez, les oreilles de l’enfant aux oiseaux, mais la corde ; au lieu de s’abattre, le cadavre s’envola, porté par mille oiseaux qui lui faisaient une traîne immense ; il survola la ville, la plus haute des tours, disparut dans la trouée d’azur, et avec lui les oiseaux des marches de la Garde-Pradeilhes qui arrivaient de tous les coins de l’horizon. Les diurnes, les nocturnes à grands coups d’ailes orbes hululant la haine, la souffrance de l’homme et du jour ; les familiers, ceux des bois, des combes, des rivières, des étangs, des falaises : les grèbes, les hérons, les aigrettes, les blongios, les canards ; les percnoptères, les aigles, les buses, les éperviers ; les autours, les vautours, les milans, les bondrées ; les busards, les Jean-le-blanc, les faucons, les perdrix ; les cailles, les faisans, les râles, les poules d’eau ; les foulques, les outardes, les gravelots, les bécasses ; les chevaliers, les oedicnèmes, les goélands, les sternes ; les tourterelles, les coucous, les hiboux, les chouettes ; les petits, les moyens et les grands ducs ; les engoulevents, les martinets, les guêpiers, les rolliers ; les huppes, les pics, les torcols, les alouettes ; les cochevis, les hirondelles, les moineaux, les cingles ; les rouges-gorges et les rouges-queues ; les pies et les grièches ; les pipits, les bergeronnettes, les troglodytes, les traquets ; les merles, les rossignols, les grives, les bouscarles ; les rousserolles, les fauvettes, les pouillots, les roitelets ; les gobe-mouches, les mésanges, les sittelles, les grimpereaux ; les bruants, les pinsons, les verdiers, les chardonnerets ; les linottes, les serins, les bouvreuils, les sansonnets ; les loriots, les geais, les choucas ; les corneilles, les pigeons, les corbeaux...
Quand le dernier oisillon des marches de la Garde-Pradeilhes eut disparu, les nuages gris se ruèrent pour obstruer la trouée d’azur ; une longue arabesque de feu embrasa le ciel ; des gueux, parmi les illettrés de la Garde-Pradeilhes, prétendirent que c’était de l’araméen, qu’elle signifiait : « Heureux les simples d’esprit, car le royaume des cieux leur est ouvert ! »
Je fis pénitence, renonçant au plaisir de mon ordre : je m’enfuis, avec le contenu des coffres de mon maître ; je me fis brigand ; j’appliquai à m’abêtir la même obstination que j’en avais mis à élever mon âme dans l’ombre de Monseigneur de P., sans jamais en retirer, quarante ans durant, la moindre satisfaction ; de Sodome en Gomorrhe, rien n’y fit : ni le vin, ni les viandes, ni le goût du sang, ni l’argent, ni les filles que je troussai, ni les garçons que je tournai ; jamais je ne connus ivresse ou remords !
Je l’ai dit : les témoignages concordants que j’eus sur ce qui s’ensuivit du supplice du Niaï, de son élévation, sont ceux de gens que je connus pour gens honnêtes ! Les oiseaux du pays de la Garde-Pradeilhes partis, les insectes, les rats, les souris infestèrent le pays : les moissons grouillèrent de vermine, ailée ou à pattes, qui n’en laissait qu’éteule ; des nuées de mouches, une coulée de rats, portèrent les miasmes, la mort, au coeur de la ville et jusque dans le plus petit des hameaux, dévorant les yeux, les orteils des plus faibles ; les mélophages, les stomoxes, les oestres pondaient dans le nez des bestiaux, les larves pénétraient les chairs, perforaient les os, s’insinuant jusqu’aux cerveaux : les vaches, prises de tournis, toupinaient, éventraient les veaux ; les moutons piétinaient les hommes ; les troupeaux entiers, en des charges-panique, hachaient menu tout ce qui se trouvait sur leur passage ! La famine peaufina l’ouvrage de la grande faucheuse : bêtes ou gens, on mourut beaucoup !
Quand chanta de nouveau le premier oisillon, combien restaient debout pour l’écouter chanter ?
Demain, je serai pendu, supplicié entre deux larrons comme l’enfant aux oiseaux, comme le Christ avant lui ; il ne se trouvera nulle prostituée, aucune Marie-Madeleine, pour pleurer à mes pieds ; les portes du royaume des cieux me sont définitivement fermées !
« Seigneur, qu’il en soit fait selon ta volonté ! »
Contes pour adultes et contes
Pour aller à l'accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Contes pour adultes et contes noirs
Jean-Claude RENOUX
nimausus@orange.fr
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
Les plus contés :
* La corrida :
http://contespourtous.centerblog.net/6255968-
* Le petit caca :
http://contespourtous.centerblog.net/6255956-
* La marque de naissance :
http://contespourtous.centerblog.net/6350027-
* L'homme aux habits de chair :
http://contespourtous.centerblog.net/6247718-
* Quelque-chose et le petit monsieur qui n'avait l'air de rien :
http://contespourtous.centerblog.net/6247702-
* Les dernières paroles de Jeanne d'Arc :
http://contespourtous.centerblog.net/6581325-
* Un homme qui boit :
http://contespourtous.centerblog.net/6581312-
* La vieille dame au tailleur rose :
http://contespourtous.centerblog.net/6461640-
* Un cochon de trop :
http://contespourtous.centerblog.net/6453959-
* Le Noël de Golè :
http://contespourtous.centerblog.net/6436755-
* Le pays des Toubabs :
http://contespourtous.centerblog.net/6395811-
* Comment je me suis débarrassé de ma belle-mère :
http://contespourtous.centerblog.net/6364441-
* Baby King :
http://contespourtous.centerblog.net/6331025-
* Le chat de l'empereur :
http://contespourtous.centerblog.net/6581980-
* La fille du roi du fleuve :
http://contespourtous.centerblog.net/6581983-
* Fable de la mi automne :
http://contespourtous.centerblog.net/6581991-
* L'ennemi de l'intérieur :
http://contespourtous.centerblog.net/6581992-
* Des avantages comparés d'avoir un chien ou un petit ami (à la demande)
Roman en ligne:
La petite qui voulait voir les montagnes danser
http://lapetitequivoulaitlesmontagnes.centerblog.net/
Autres :
* Le bouscatier et la chèvre d'or :
http://contespourtous.centerblog.net/6581360-
* L'homme à qui les morts parlaient :
http://contespourtous.centerblog.net/6581415-
* Cosmogonie:
http://contespourtous.centerblog.net/6572111-
* Les trois rêves:
http://contespourtous.centerblog.net/6518371-
* Le diable à Montaren :
http://contespourtous.centerblog.net/6256254-
* Les bavarelles :
http://contespourtous.centerblog.net/6256177-
* Le diable et le fossoyeur facétieux :
http://contespourtous.centerblog.net/6256167-
* La bête du Gévaudan :
http://contespourtous.centerblog.net/6256154-
* Le jour et la nuit :
http://contespourtous.centerblog.net/6256138-
* Le petit garçon qui cherchait la petite bête :
http://contespourtous.centerblog.net/6256129-
* Le roi des grenouilles :
http://contespourtous.centerblog.net/6256111-
* Le mari trompé :
http://contespourtous.centerblog.net/6256046-
* L'homme qui voulait être enterré avec le soleil :
http://contespourtous.centerblog.net/6247715-
* L'homme que les chiens n'aimaient pas :
http://contespourtous.centerblog.net/6581430-
* La folle de l'impasse du Teilh :
http://contespourtous.centerblog.net/6581358-
* Kiravi, jambon beurre :
http://contespourtous.centerblog.net/6581462-
* La négresse blanche :
http://contespourtous.centerblog.net/6581347-
* Voyage :
http://contespourtous.centerblog.net/6572074-
* Les désarrois de madame de Beaurepaire ;
http://contespourtous.centerblog.net/6473448-
* Il est cocu le chef de gare :
http://contespourtous.centerblog.net/6404256-
* Le vieux con :
http://contespourtous.centerblog.net/6247716-
* Brown Rabbit :
http://contespourtous.centerblog.net/6338531-
* Lucinda :
http://contespourtous.centerblog.net/6318309-
* Koko :
http://contespourtous.centerblog.net/6311306-
* Le miracle de l'enfant aux oiseaux :
http://contespourtous.centerblog.net/6581968-
Mais aussi, contes plus longs :
* La nuit de la mandrette (accueil) :
http://contespourtous.centerblog.net/6581957-
* La noix babou (accueil) :
http://contespourtous.centerblog.net/6582034-
* la passion selon saint Roch (accueil)
Kiravi jambon beurre
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
nimausus@hotmail.fr
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
Retour à la page "contes pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
Kiravi et jambon-beurre
L’homme était allongé de tout son long sur un banc de zinc à gros rivets. À l’annonce de certains trains, il se levait, s’allongeait dans le couloir. Il étendait la jambe, assez pour gêner, sans obstruer le passage ni provoquer de réactions hostiles, suffisamment pour gagner quelques pièces. Quand il avait de quoi acheter une bouteille de kiravi, du gros gris, un sandwich jambon-beurre, il retournait sur son banc. Il avait l’habitude de passer inaperçu, l’habitude des trains, de la menue monnaie, du jambon-beurre. Et du kiravi. Il buvait pour s’embrumer l’esprit, en attendant le train suivant.
Un papillon blanc voleta jusqu’à lui. Sans trop savoir pourquoi, il suivit le papillon. L’homme ne quittait jamais la gare sans nécessité. Il descendit une rue sans trottoir, avec tout son barda, malgré les coups de klaxon, les coups de frein, les injures. Une odeur de croissant chaud lui fit tourner la tête. Il saliva en contemplant les gâteaux à la devanture de la pâtisserie qui faisait l’angle avec une rue à bistrots. Les larmes lui vinrent aux yeux. Il sentit sa gorge se nouer, son estomac se contracter. Il hâta le pas. Le papillon blanc l’entraîna vers une ruelle pavée, que creusait un caniveau central à larges dalles.
Une impasse. Un mur mangé de lierre, de glycine. Un portail courbe, à la manière de ceux qui ornent les maisons campagnardes du siècle dernier, dressait ses pierres rousses. Une courette de gravier blanc crissait sous les pas, devant un pavillon de pierres saillantes, blanches, rousses, aux boiseries peintes de vert, que baignait un parterre de fleurs. Au fond du jardin potager jouxtant la maison, des ruches ! Le papillon entra ! L’homme passa la tête à travers le rideau de perles. Il vit les jambes sur les carreaux de la cuisine. Ni sang, ni arme ! Le visage de la vieille était cyanosé. Les ailes du nez palpitaient légèrement. Sa main se crispait sur l’archet du violon. Il feuilleta le bottin. Il lui échappa à trois reprises. Le Samu. Il dut s’y reprendre à deux fois pour téléphoner. Il balbutia quelques mots dans l’appareil sur la vieille, comme quoi elle avait eu un malaise. Il indiqua vaguement l’endroit, se souvint du mot en fer forgé à droite du portail, cantabile. On lui demanda son nom, son adresse, son numéro de téléphone… Il raccrocha. Il vit la pomme, fichée dans un bâton ; une de ces pommes enrobées de caramel et de sucre rouge qu’on vend dans les foires et qu’on appelle Pomme d’Amour. Il la fourra dans sa poche. Une voiture de police s’engagea dans la ruelle. Quelques minutes plus tard, une ambulance passait, toutes sirènes hurlantes.
Quelques mois s’étaient étirés depuis le jour de la vieille au violon. L’homme qui n’avait pas de maison avait retrouvé son banc de zinc à gros rivets. Il grommela en voyant de nouveau le papillon. Il descendit la rue sans trottoir, avec tout le barda, les coups de klaxon, les coups de frein, les injures. L’odeur de croissants chauds. La pâtisserie à l’angle de la rue des bistrots. La ruelle pavée, le caniveau central à larges dalles.
Le rideau de perles teinta. Il avait oublié de frapper ! La vieille le regarda en ouvrant grand la bouche et les yeux. Il s’empressa de dire : “ La pomme, c’est moi ! ” La vieille ne comprit pas. “ La pomme rouge, avec le bâton, c’est moi qui l’a prise, le jour de l’accident ! ” Elle ne comprenait toujours pas ! “ Ben oui. Le jour de l’accident, c’est moi que j’ai appelé au secours ! ” Le visage de la vieille s’illumina. “ Oh, c’est vous ! ” Il baissa la tête. “ Ben oui, c’est moi ! ” Elle le fit entrer dans le salon. Elle l’invita à s’asseoir. Il s’enfonça dans le crapaud de velours rouge. Comprenant le caractère incongru de sa présence, il voulut se lever. Elle insista, lui proposant du café, du thé, des petits gâteaux.
“ Z’auriez pas du vin, plutôt ?
- Du bourgogne ?
- Z’auriez pas du kiravi ?
- Non, je suis désolée !
- Bon, ben du... comme vous dites ! ”
Elle en servit deux verres.
- Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?
- J’sais pas. Un peu d’argent. J’ai pas l’habitude ! ”
La vieille fouilla dans son sac, en tira un billet de 500 F. Il recula. “ C’est trop, j’l’ai dit. J’ai pas l’habitude ! ” Elle réfléchit : “ Vous aimez la musique ? ” L’homme chercha. “ J’sais pas. Avant, p’t’êt. ”
Elle prit le violon dans le boîtier, sur le bahut de la cuisine. L’incrustant dans son épaule, elle se recueillit un long moment. Elle lisait, comme elle répondait à ceux qui l’interrogeaient sur ce qui se passait dans ces moments-là. La première phrase s’imposa ! C’était la ronde des lutins de Bazzini. Ses doigts libéraient les premières notes, qui s’envolaient dans la pièce. Elle oubliait l’homme. Tout son corps vivait la musique, elle n’en était que le médium, l’esclave. La vieille s’inclinait, se relevait, sa tête scandait à petits coups de menton appuyés les moments forts, vifs. Elle berçait le violon dans les passages doux, tendres. Elle souriait, grimaçait, se faisait grave. Son visage se couvrait de milliers de petites rides, sa bouche se tordait, le dentier bougeait un peu. Elle adoptait des mines de petite fille gourmande. Sa frimousse s’illuminait...
Pantelante, transie, les ailes du nez palpitantes, la vieille dame laissa retomber l’archet à son côté. Les yeux pétillants d’intelligence, de vivacité, étonnamment vive et jeune, et belle, elle se tourna vers l’homme. Il dormait dans le crapaud ! Elle se laissa choir sur l’autre fauteuil, pleurant silencieusement pour ne pas le réveiller !
“ Je ne vous attendais plus ! ”
Il écarta les bras. “ J’voulais pas rev’nir, j’veux pas m’attacher, c’est pas bon ! Pis, j’m’suis dit qu’y avait pas de mal à se faire du bien, de temps en temps, j’suis venu !
- Pour le kiravi !
- Pour la musique aussi ! ”
Elle prit le violon dans les bras : “ Aujourd’hui ce sera Beethoven, à vous d’imaginer l’orchestre qui va avec.
- J’sais pas faire !
- Tant pis, ce sera Beethoven ou rien ! ” Elle entama les premières phrases du concerto pour violon opus 61.
L’homme se retourna sur son banc, d’un bloc. C’était la musique de la vieille, ce Ben Touvé, ou Ben Touvié ! Ça lui donnait des idées. Des images qui venaient comme ça, par vagues. Elles s’enchaînaient sans fin, toujours les mêmes. Des images, du temps où il avait une femme, du temps où il travaillait, du temps où il était en prison, quand il était interné à l’asile. Comme un livre ! Lui qui n’en lisait jamais, qui n’avait jamais aimé lire. Une histoire qu’il connaîtrait, qui ne le concernerait plus, avec de la musique dessus, tout en couleur. Plus fort qu’au ciné ! Rien que pour lui...
Elle pensa à cet autre Job, qui venait la voir, qui lui avait sauvé la vie, qui aimait les Pommes d’Amour. L’idée naquit comme un coquelicot au milieu d’un champ de blé. Elle consulta les pages jaunes, décrocha le téléphone...
L’homme au banc sommeillait entre deux trains. Il sursauta quand l’éclair l’éblouit. L’homme à l’appareil balbutia que c’était pour le journal ! L’homme au banc le regarda s’éloigner sans comprendre. La chose se reproduisit à trois reprises ! Le jour suivant, un voyageur s’arrêta, déposa une Pomme d’Amour dans le bonnet gris. Il lui sourit en lui parlant de l’article, dans le journal. L’homme au banc ne comprenait toujours pas ! Il appréhendait le moment où quelqu’un s’approcherait, en souriant. Quelqu’un qui déposerait une nouvelle Pomme d’Amour. Il en avait maintenant une bonne centaine devant lui. On l’appela : M. Brès ! L’homme au banc se dressa, sur ses gardes. Un voyageur s’assit à côté de lui, lui montra le journal. L’homme au banc vit la photo, il écouta l’interview de la folle au violon. L’homme au journal lui posa la main sur l’épaule. L’homme au banc sursauta, se dégagea. Il vit l’homme au sourire, l’homme à la caméra, toute l’équipe. Il hurla ! Ces messieurs de la télé remballèrent sourire et caméra. L’homme au banc vivait un calvaire. Il en perdit le sommeil !
On s’habitue à tout. On se lasse de tout. L’homme au banc retourna à l’oubli ! Il n’irait plus chez la vieille. La vie grise reprit son cours. Le hall ressemblait de nouveau à un dimanche d’automne, après messe. Les kiosques ouvraient, fermaient avec la même régularité.
Il ne viendra pas, il ne viendra plus. Job ! Le violon gisait sur le sol de parefeuilles. Brisé ! Elle se dirigea vers le buffet. Les plaquettes de valium et la bouteille de Vodka étaient là, comme la dernière fois. Elle sourit : cette fois, elle n’oublierait pas de fermer la porte à clé !
La douleur se fit plus forte, dans sa poitrine. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Le sang encombrait ses poumons. Son cœur était sur le point de péter. Passer inaperçu, surtout passer inaperçu. L’homme s’était tassé sur lui-même. Il cachait son visage aux passants... Il vit la vieille dans le hall ! Elle venait dans sa direction. La douleur s’apaisa, disparut. La folle au violon n’avait pas d’autres bagages que son étui ! Elle portait une robe à fleurs, un chapeau de paille. Environnée d’une nuée de papillons blancs. Ses bottines de cuir ne faisaient aucun bruit. Des milliers de coquelicots naissaient sous ses pas. Un déluge de lumière creva les murs de la gare !
L'homme que les chiens n'aimaient pas !
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
nimausus@hotmail.fr
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
Retour à la page "contes pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
L'homme que n'aimaient pas les chiens
Il avait marché longtemps. On ne sut jamais ni son nom, ni quel pays l'avait vu naître, ni d'où il venait, ni à quel saint, quelle religion il se vouait, ni ce qu'il faisait dans ce chaos de montagnes déchiquetées, dépecées par les vents, calcinées par le soleil, dévorées jusqu'aux os par la neige. Quoique jamais ni les vents, ni le soleil, ni la neige n'eussent soumis le pays à telle violence que le temps lui-même : les montagnes témoignaient de blessures immémoriales, ce n'étaient que chairs meurtries, froissées, os brisés mille fois, en un fatras pantelant de rochers blancs, gris, couche sur couche, déchiré tel un titanesque jeu de cartes pour dieux ou pour géants... Drainé par les vallats, la pâte des monts environnants nourrissait une ferme, quelques prés, un jardin, protégés par les faïsses de la pugnacité du temps... L'homme avait frappé à la porte du mas. La source de Palières était gelée : ce n'était pas un temps à laisser un chrétien dehors. Le père Peiredon lui avait offert un bol de soupe, le vagabond avait marqué son contentement d'un claquement de langue, le fermier lui avait proposé de rester, pour l'hiver, de se rendre utile : il y avait du bois à couper, de petits travaux pour meubler le temps en attendant le printemps... Quand les beaux jours égayèrent les grands arbres secs de premiers bourgeons, alors que les champs, les prairies, se couvraient de fleurs, que l'herbe dégouttante de sève verte frissonnait au moindre ventolet, l'homme s'était rendu indispensable : sans jamais prononcer le moindre mot, sans jamais rire ni sourire, sans jamais s'exprimer autrement que par un petit claquement de langue pour marquer son contentement, son irritation, sa frustration, il oeuvrait, se levant avec les poules, se couchant avec le soleil... Deux ans plus tard, il occupait toujours le même coin de grange, mangeant à la table des Peiredon ! Il inquiétait, avec ses gros yeux bleus qui lui sortaient des orbites, qui vous regardaient fixement, vous glaçant l'âme, vous contraignant à détourner le regard. C'étaient les seules choses qui semblassent vivantes dans ce visage taillé à coups de serpe, avec tous ses poils noirs qui s'extravasaient à foison des narines, des oreilles, et l'énorme limace noire des sourcils, velue, d'un seul tenant. Les cheveux étaient roux, comme le teint de l'homme, le bas du visage gris d'une barbe qu'il ne parvenait jamais à raser tout à fait... Il marchait en allongeant la foulée, sans que le haut du corps ne bougeât. Les piquets des deux bras pendaient, interminables. On ne s'était jamais habitué à sa présence, il ne faisait pas partie de la famille, comme à la longue les valets, les servantes. C'était quelque chose comme une bête de somme, qui devançait les ordres, obéissait sans broncher ! Sans le père Peiredon, il y a beau temps que les filles, la maîtresse, l'auraient chassé. Pour les femmes, il était le Diable. Elles en donnaient pour preuve le comportement des chiens : dès qu'il paraissait, le bâtard rouge et noir à longs poils du maître grondait. Lorsqu'il approchait d'une ferme, les chiens mis en fureur tiraient sur leur chaîne, s'étranglaient à moitié pour se jeter sur lui. Ça tenait à son odeur, ou parce qu'il n'aimait pas les chiens : les bêtes gueulaient. Le regard bleu devenait glacé, les mâchoires se serraient, les dents crissaient, un peu de bave dégoulinait au coin des lèvres étroites que souillait parfois un mince filet de sang, le teint tournait gris, du même gris que le menton jamais rasé... Le maître laissait dire les femmes. Il égrenait la litanie des travaux auxquels elles devraient s'atteler si l'homme n'était pas là. Il concluait toujours par : " La saison prochaine, je lui donnerai congé ! "
Un beau jour, le maître céda ! L'autre partit sans un mot faire son baluchon : quand il revint, les muscles de sa main blanchissaient à force de serrer la serpe. Rien n'y fit, ni les supplications, ni les plaintes, ni les râles, ni les coups : l'homme semblait insensible, de corps et d'âme. Quand il déposa enfin la serpe sur la table où l'on avait dressé le souper, le mas comptait neuf cadavres : le maître, la femme, les trois filles, le gendre, la servante, les deux valets ! L'homme referma soigneusement la porte, il aspira un grand coup, il ajusta son baluchon sur l'épaule. Il repartit, en allongeant la foulée, sans que le haut du corps ne bougeât, les bras comme des piquets, interminables... Le chien de la maison hurla à la mort ! Il se secoua, comme s'il sortait d'un long, long, long sommeil. Il fit demi-tour, marcha sur la bête qui gueula de terreur. Les chiens des mas environnants lui firent écho... D'un coup de pierre, l'homme l'assomma. Il s'acharna sur le cadavre jusqu'à n'en laisser qu'une bouillie informe... Il reprit la route, pressé de laisser entre lui et les meurtres le plus de distance possible : avec un peu de chance, en se cachant des hommes, en se nourrissant d'écorces, de petits animaux, il gagnerait la Suisse, il s'y ferait oublier, quelques années...
Il marchait vite. Dans le bois de Laune le piège à loups se referma sur sa cheville, lui arrachant sa première plainte, depuis des mois, ou des années. Le soir n'était plus loin, la colère avait consummé ses forces : il ne parvenait pas à desserrer les mâchoires qui lui broyaient la cheville, les dents d'acier plantées dans les os... Les loups se mettraient bientôt en chasse. Il hurla de terreur, comme une bête. Les chiens, à cinq lieues à la ronde, lui firent écho : ceux des Capelans, les chiens à loups de la Calquière, les bergers de la Remise, les chasseurs des Malines, le gros roux du moulin de Vitou, le borgne du Bijournet, le boiteux des Curières ! Plus il hurlait, mieux les chiens répondaient. Les appels approchaient... Le noir et feu du Martinet se dressa non loin d'un châtaignier, les bergers de la Remise déboulèrent de derrière un massif de hêtres... Deux cents gueules dégouttaient de bave et de haine. Quatre cents yeux rouges flambaient dans l'obscurité naissante. Le gros roux du moulin de Vitou, d'un bref claquement de mâchoire, donna le signal de la curée... L'homme rit, pour la première fois : les loups n'auraient pas sa peau !
L'homme à qui les morts parlaient
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
nimausus@hotmail.fr
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
Retour à la page "contes pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
L'homme à qui les morts parlaient
La salle à manger est classique, la villa récente : Martin loue la vieille maison familiale de la grand'rue de Saint-André de Valfons à des jeunes venus de la région parisienne. Il en sera de ceux-là comme de bien d'autres. Comme les Allemands, les Hollandais, les Suisses, les Anglais avant eux, ils se lasseront de ces vieux murs qui suintent l'humidité à longueur d'année, sans que l'on n'y puisse rien. Dans quelque temps les draps, le linge, les livres prendront l'odeur. Ils voudront retourner à la Garde-Pradeilhes, dans des H.L.M. qui leur rappelleront la région parisienne, ou bien ils investiront dans un lotissement ! En attendant, Martin leur loue la maison de ses grands. Il réside aux écarts, comme la plupart des anciens Valfonais : il a construit la villa sur des terres à vigne, avec piscine, garage. Il fait comme tout le monde : dans le touriste... Il tourne lentement son verre de cartagène entre ses gros doigts de paysan. Il sourit avec amertume en songeant au passé : " Je ne dis pas que c'était mieux avant : il faut avoir noué comme moi des balais de genêts jusqu'à des quinze heures par jour. La gorge me grattait, jour et nuit. Mon commerce de la Garde-Pradeilhes à côté, c'est une sinécure. On ne peut pas dire non plus que les femmes étaient plus heureuses quand il leur fallait aller laver le linge au lavoir, ou charrier l'eau depuis la fontaine. Je te raconte pas la corvée quand on faisait ses besoins dans des seaux, ni l'odeur des rues en ce temps-là. Mais enfin, on se connaissait : maintenant, quand je vais au village, je ne connais pas trois personnes sur quatre. Surtout, on se parlait, c'est ça que je regrette... " Soudain une pensée allume un éclair dans son regard noir : " On parlait même avec les morts, ou plutôt c'est eux qui vous parlaient ! " Sa femme sursaute : " Tu vas quand même pas lui raconter ça ? " J'ai insisté !
" Tu connais Saint-André : chez nous les catholiques et les protestants se sont étripés deux ou trois siècles durant. Les catholiques y étaient majoritaires, contrairement à la Garde-Pradeilhes... Ça a laissé des traces : aujourd'hui il n'y a plus rien, on fait dix kilomètres en voiture pour aller au supermarché. Avant la grande guerre il y avait deux cafés, deux épiciers, deux médecins, deux bouchers, deux charcutiers : un pour chacune des religions. Entre les deux guerres, ça a un peu changé : le clivage s'est fait entre la droite et la gauche. Ca recoupait encore les anciennes divisions : les protestants étaient plutôt de gauche, les catholiques plutôt à droite. Pendant la résistance, c'est à Saint-André qu'il y a eu le plus de miliciens, mais dans le maquis c'était déjà mélangé... Après la Libération, les Rouges, comme on disait, se réunissaient au " bar de l'avenir ", l'ancienne auberge protestante, que les communistes appelaient " la section " : on y trouvait des natifs de Saint-André, catholiques et protestants, des Italiens antifascistes, des Polonais rescapés des mines, de la silicose, des camps, des maquis, des anarchistes espagnols, des Hongrois, des Roumains... Et Pibol, qui s'y rendait tous les soirs, pour boire, avec son protégé, le Firmin Puech. On l'appelait Pibol parce qu'il avait eu la polio étant petit : lorsqu'il marchait, il se cassait brusquement sur le côté, comme un peuplier sous le vent. L'usage de Saint-André voulait qu'un infirme par famille soit employé municipal : Pibol était devenu balayeur. On le croisait vingt fois dans la journée, vêtu hiver comme été d'un pantalon bleu de chauffe, d'une veste en velours sur une chemise couleur crasse, terre et mousse - tu comprendras plus tard pourquoi ! - chaussé de vieilles godasses déglinguées qu'il rafistolait avec des morceaux de ficelle, promenant sa charrette à bras d'où dépassait un balai de genêt ( semblable à ceux que je faisais avant le magasin ). Le soir donc, il se rendait au bar de l'avenir. Autour d'un poêle à sciure, quelques tables à plateau de marbre, des chaises cannelées, derrière le comptoir un portrait de Staline, de Thorez, sur le sol du lino. On y discutait, on y lisait " La Marseillaise ", " Mundo Obrero " ! Les cocos et les anars espagnols s'engueulaient, s'accusant d'être responsables de la chute de la République... Pibol s'envoyait sept ou huit canons, avec le Firmin Puech. Comme il avait déjà éclusé six litres de vin durant la journée - pas un de plus : " après, c'est du vice " - on le croisait à la brune, le teint rouge, serrant les lèvres, s'efforçant de marcher droit tout en s'appuyant aux murs : " Ça souffle, Pibol ? - Saloperie de vent : il se lève tous les jours à la même heure ! " Il gagnait dignement le cimetière catholique, où il s'endormait d'un bloc, dans le caveau familial. Sa masure avait brûlé, et c'était bien la seule chose qui lui appartint encore en propre : il était le dernier Langrenon - c'était son véritable nom - vivant. Les autres, les crétins goitreux, les mongoliens produits des mariages consanguins, des maladies honteuses ramenées du service militaire et des colonies, s'étaient, Dieu merci, éteints sans descendance... Coucher avec les morts, les belles âmes de Saint-André trouvaient bien à y redire : pas trop fort. Pibol était intouchable, pour quelque temps encore : il avait ravitaillé la Résistance quand la plupart des familles catholiques bien pensantes avaient eu l'un des leurs fusillé lors de l'épuration ! Il aurait préféré le cimetière protestant, plus gai, plus vivant, avec son mur de pierres tout-venant, de celles qu'on trouve sur place, rouges, ocres, violette, noires, orangées, comme les vieilles maisons du village, plutôt que le cimetière catholique, crépi, gris, impersonnel, triste à mourir... On ne choisit pas plus sa famille que sa religion ou son cimetière : Pibol était né catholique, il le restait, quoiqu'il ne fréquentât jamais l'église, qu'il dît pis que pendre des curés, des bigotes, des calotins. C'était une vilaine maladie à laquelle on ne pouvait rien, pas plus Pibol que qui que ce soit ! Bref : il dormait avec les morts. Le bruit courut qu'ils lui parlaient. Il ne se privait pas pour prétendre que la tante du Fernand demandait des nouvelles de ses chèvres, que la belle-mère de la Louise lui faisait dire qu'elle continuait à la maudire... Les habitués du " bar de l'avenir " connaissant son passé de résistant, quoiqu'ils se disent pour la plupart athées, ça ne portait pas à conséquence !
On trouva la mère Maresse étranglée : quelqu'un était entré dans la mercerie de la vieille, quelqu'un qui l'avait fait passer de vie à trépas avant de lui voler sa caisse. Ce n'est pas qu'on affectionnât vraiment la vieille vache qui colportait les ragots les plus invraisemblables, qui s'était enrichie durant la guerre avec le marché noir, dont l'avarice était proverbiale : quand même, ce fut un sacré choc pour le village. Les gendarmes firent une enquête. Faute de preuves, ils classèrent l'affaire...
On évoqua de nouveau le meurtre au " bar de l'avenir ", le père Moulinat ( tu l'as connu, c'est le marchand de poulets qui t'a vendu la maison ), pour blaguer, a demandé à Pibol : " Au fait, elle te dit rien à toi, la Maresse ? " Ce dernier ouvrait la bouche pour répondre quand le fils du boucher, le gros Firmin Puech, une manière de colosse, avec un visage de gosse, un ventre énorme, qui ne trouvait jamais de vêtements à sa taille, qui montrait toujours son nombril, la moitié de son cul ; le gros Firmin à qui on n'avait pas grand chose à reprocher à part quelques chapardages ici et là ; le gros Firmin, que l'on croyait doux comme un enfant, un rien débilou, se jette sur Pibol, lui serre le kiki, en hurlant : " Tu vas la fermer, dis, tu vas la fermer ! " On a eu tout le mal du monde à lui faire lâcher prise. Le Firmin Puech s'est enfui ( personne n'a essayé de le retenir : ce n'était pas le genre de la maison d'aller trouver les flics... ) Le gamin ( je dis le gamin, mais il devait avoir passé la trentaine ! ) s'est pendu dans la nuit... "
Martin tourna quelques secondes son verre de cartagène entre ses doigts, les yeux perdus dans le vague : " Pibol a gardé de l'incident une certaine raideur dans la nuque. On voyait bien qu'une grande tristesse le minait. Quand on lui demandait si le Firmin lui faisait des confidences, il hochait la tête, anéanti : " Il me parle plus, il est fâché ! " Lui-même s'est réveillé mort peu après, dans son caveau. Je ne peux pas te dire s'ils se sont réconciliés ! "
Le bouscatier et la chèvre d'or
Retour à la page accueil :
http://contespourtous.centerblog.net/6582066-
Jean-Claude RENOUX
nimausus@hotmail.fr
25, rue de l'Aspic
30000 Nîmes
Tel 0466214265
Retour à la page "contes noirs et pour adultes" :
http://contespourtous.centerblog.net/6581942-
Le bouscatier et la chèvre d'or
En ces temps-là vivait au village de Laudun un jeune homme qui s'appelait Guilhem Bourdiguet ; bouscatier (homme des bois), il courait les bois et les bosquets, en compagnie d'un grand chien fou et roux qui avait nom Badarous, une brave bête de chien qui aimait courser le lièvre et le lapin sans jamais en attraper aucun, pendant que son maître oeuvrait à faire des fagots et du bois à brûler ( la lenhe, comme on dit en provençal ). Le Bourdiguet fournissait le boulanger bien sûr, et les nombreux potiers, mais encore le seigneur auquel il devait taille et corvées ; comme c'était un brave homme, il approvisionnait aussi les indigents de la paroisse de Laudun, qui ne manquaient pas - hélas ! - en cette époque où le malheur était chose commune. Le Bourdiguet était d'humeur plaisante, il aimait rire et plaisanter, et il n'épargnait de ses saillies ni les riches, ni le clergé. Pour son bonheur il avait marié une fille d'Orsan, tendre comme la mie du pain et gentille comme une nuit de Noël les années où il y a du feu dans la cheminée et de quoi boire et manger sur la table ; et la femme lui avait donné un fils, qui se prénommait Guilhem, comme le père.
Il en fut toujours ainsi des pauvres gens : leur humble bonheur fond tout aussi aisément que neige au printemps ; le drame se produisit dans le bois seigneurial, alors que Badarous barrulait (vagabondait) dans les taillis. Soudain un coup de feu claqua, et le chien roux et fou boula parmi les épineux ; le seigneur apparut, à cheval, le pistolet fumant au poing :
- Il y a longtemps que je te guette, Bourdiguet ; c'est fini, ton chien ne braconnera plus mon gibier !
- Mais jamais...
- C'est ta parole contre la mienne. Tu t'es trop longtemps moqué de moi et des miens ; je n'ai été que trop patient. Rassure-toi : on dit ta femme aimable et douce ; c'est gâchis pour un vilain comme toi ; je saurai bien comment la consoler pendant que tu rameras aux galères ! ”
Le seigneur partit d'un rire énorme, tellement que sa vue se brouilla ; il ne songeait plus à surveiller le malheureux bouscatier : ce fut là sa perte ! Aveuglé de chagrin et ivre de colère, le Bourdiguet prit la jambe du méprisant personnage, et le désarçonna ; comme il se ruait pour l'estourbir (l’assommer) il vit, à l'inclinaison de la tête, que la nuque s'était rompue dans la chute : le seigneur était tout ce qu'il y a de plus mort ! Le jeune homme se dirigea ensuite vers le chien : il vivait encore, mais pour combien de temps ? La blessure ferait soupçonner le bouscatier du meurtre du seigneur ; il ne pouvait être question de s'en retourner avec Badarous à Laudun. Une pensée folle traversa l'esprit du Bourdiguet : il avait vu souvent les animaux blessés se traîner vers le lieu-dit “ le Puget ”, non loin de la tour et des ruines romaines qu'on nommera plus tard “ le camp de César ” et qui surplombent la vallée de la Cèze ; les bêtes y disparaissent soudain au détour d'un rocher, ou derrière quelque massif de ronces et de genêts ; plus d'une fois il en avait cherché les dépouilles : nulle trace ! Il se rendit au Puget, espérant un grand miracle, ou tout au moins un petit sortilège ; il erra, longuement, avant de s'affaisser, désespéré, au pied d'un chêne blanc ; il se prit à pleurer, jusqu'à ce qu'il aperçût une chèvre au pelage doré qui le regardait ; curieusement, plus le regard de l'homme se voilait, plus il la distinguait nettement. LA CABRE D'OR ! Le Bourdiguet en connaissait la légende : elle aurait son royaume dans les profondeurs du mont sur lequel est édifiée la tour romaine ; on la dit gardienne des richesses enfouies ; elle seule sait comment accéder aux vastes salles souterraines où s'amassent les trésors oubliés des hommes ! La chèvre mythique s'approcha du pauvre bouscatier et, d'un regard amical, l'invita à la suivre. Ils marchèrent quelque temps, contournant le mont de la tour romaine, pour pénétrer dans la combe de Roubeau ; la végétation dense, qui en interdisait l'accès aux humains, s'écartait sur le passage de la chèvre d'or ; enfin, ils parvinrent devant un chêne extraordinaire, le plus considérable que le Bourdiguet eût jamais vu ; la cabre merveilleuse frappa trois fois le sol de ses sabots dorés ; les racines maîtresses s'écartèrent pesamment, révélant un escalier descendant qui donnait accès à une porte d'azur ; le Bourdiguet, toujours portant Badarous, s'engagea derrière la chèvre ; ils parvinrent dans une salle immense où, parmi un grand désordre d'or, d'argent, de bijoux précieux jonchant le sol, régnait une animation peu commune : outre des bêtes par milliers, dont certaines semblaient dormir, il s'y trouvait une armée de petits lutins blancs qui s'affairaient à transporter et à soigner les animaux blessés. Le dominant de sa superbe, un grand dadais à face de carême semblait orchestrer tout cet affairement ; un dadais avec des bras démesurés et des jambes considérables !
Dans les jours qui suivirent, le Bourdiguet apprit à connaître et à apprécier les hôtes singuliers de la cabre d'or. Figurez-vous que l'animal légendaire s'était lassé de veiller sur des montagnes de matières rutilantes mais inanimées ; elle s'était dit que la vraie richesse était ailleurs ; la merveille des merveilles, c'était la vie elle-même, cette étincelle extraordinairement fragile, infiniment précieuse animant tout être vivant, de la minuscule fourmi besogneuse, au grand et noble cerf courant librement par bois et futaies ; aussi la chèvre fabuleuse accepta-t-elle de partager son royaume avec les Nasbinels ! On nommait ainsi les lutins qui avaient trouvé refuge au plus profond des grottes, ou au sein même de la terre, lorsqu'on intima aux humains de ne plus croire aux êtres surnaturels ; les gripets (petits bonhommes) rouges, verts, bleus y perdirent leurs belles couleurs rouge, verte, bleue, pour devenir d'un blanc uniforme ; ils y gagnèrent la faculté de se confondre avec leur environnement quand la vocation les poussait à remonter en surface ; les Nasbinels s'étaient donné pour mission de sauver les bêtes blessées par les hommes avant que d'autres prédateurs ne les dévorassent ; ils avaient organisé tout un réseau de couloirs et de galeries souterraines qui joignaient les puits des humains aux vastes salles du royaume de la cabre d'or ; là, le grand dadais à face de carême se chargeait de faire patienter les cas les plus graves, en attendant que de bonnes fées s'en viennent les soigner et les guérir. Le Nivernet, puisque c'est ainsi que se nomme le dégingandé, ne restait pas à demeure dans les profondeurs du mont du camp de César : il bénéficiait d'une situation autrement élevée, puisqu'il était, l'ordinaire du temps, le cuistre de saint Pierre et sa créature ; voici comment :
Un jour, saint Pierre s'en fut trouver Dieu le père, et se plaignit à lui :
- C'st bien la peine d'être le premier des saints, et d'avoir été le premier des papes ; tout ça pour n'être pas mieux considéré que je ne le suis !
- Eh bien, mon bon saint Pierre, de quoi te plains-tu !
- Seigneur, pourquoi suis-je le seul à travailler encore après avoir gagné ma place ici-haut ? Les autres saints ont beau rôle à jouer les saints patrons, les sentencieux, les magnanimes : c'est moi qui accueille les nouveaux arrivants ; je dois trier, refouler, prôner la discipline, faire le moralisateur, gourmander, jouer les rabat-joie, subir reproches et doléances, couvrir des pages et des pages de votre grand registre des entrées de votre paradis, manipuler l'énorme clé que vous m'avez confiée, la porter sans cesse pendue à la ceinture, elle m'encombre, elle me meurtrit et me bat les flancs ; sans compter les moments de grands débordements : les grosses épidémies, les guerres de religion ! Qu'ai-je donc en compensation de mon temps et de ma peine ? RIEN !
- Que voudrais-tu donc mon bon saint Pierre ?
- Un cuistre, Seigneur, pour secouer deux ou trois fois l'an mon oreiller, mon traversin et mon édredon afin que je puisse confortablement reposer !
- Un cuistre ! Comme tu y vas ! Jamais un saint n'acceptera pareille dérogation ; quant aux humains, ils n'ont pas gagné le royaume des cieux en ce monde-là, pour continuer à servir un grand et un puissant de ce monde-ci, fût-il le plus grand parmi les saints, et le premier des papes !
- Eh bien, créez-en un !
- Rien que cela ! J'ai perdu le tour de main ; par contre je veux bien t'accorder le privilège exclusif de créer par toi-même, une unique fois ; ce sera là le seul être vivant dont je ne serai pas l'auteur. Peut-on rêver plus grande marque de confiance et de considération, mon bon saint Pierre ?
- Grand merci, Seigneur ! ”
Saint Pierre s'attela sans attendre à la tâche, et il naquit de ses mains l'original à face de carême qui porte le bras démesuré pour mieux secouer l'oreiller, le traversin et l'édredon de son créateur ; et la jambe considérable pour mieux se pencher au-dessus des nuages. On dit que lorsque le Nivernet est au travail ; ces jours-là sont jours de neige !
Que faisait donc le Nivernet parmi les Nasbinels ? Le service du grand saint laissait au cuistre bien du temps libre ; bien qu'il affichât de ne parler qu'avec affectation, il avait le coeur gros de tout le malheur du monde, et il était bon comme le pain du voisin ; il s'émut de voir les Nasbinels se démener pour sauver les animaux victimes des hommes, et il consacra ses vastes loisirs à les seconder : afin de permettre aux blessés d'attendre le secours des fées, le gentil cuistre soufflait doucement sur les bêtes pour les placer en état d'hibernation. De temps en temps, le Nivernet s'accorde quelques repos ; il s'en va tout en haut du mont de Vigueux, pour méditer sur le monde d'ici-bas, comme il va... Ces jours-là l'entendent pousser un énorme soupir ; et la campagne se voile de gelée blanche !
Et le Bourdiguet, dans tout cela, me direz-vous ! Il resta auprès de la cabre d'or, des Nasbinels et du Nivernet des semaines et des semaines durant ! Combien exactement ? Le Bourdiguet n'aurait su le dire ; le temps nécessaire à la guérison de Badarous ! Enfin le chien fou et roux se mit debout, il fit quelques pas dans la vaste salle de la cabre d'or, puis il se plut à chahuter avec les animaux convalescents ; le bouscatier comprit qu'il était temps de regagner Laudun ! La chèvre d'or les guida de nouveau vers la porte d'azur ; elle frappa trois fois le sol de son pied doré ; la combe de Roubeau était là, luxuriante ; de nouveau, la végétation leur livra chemin ; passé la combe, la cabre d'or s'en retourna, sur un ultime regard amical !
Quand le bouscatier découvrit la plaine au détour du mont de la tour romaine, il eut du mal à reconnaître le pays qui l'avait vu naître ; c'était Laudun, sans doute, mais remanié par une main maléfique ; les champs, les routes semblaient remodelés ; des potences couraient par monts et par vaux, et des fils tendus les reliaient les unes aux autres ; des enseignes fichées en terre agrémentaient des chemins qui n'étaient ni de terre, ni de pierre ; au loin il voyait quelques nouveaux châteaux, bien laids - ou prisons, bien grises ; hérissées de tours et de cheminées fumantes, les bastides parsemaient l'horizon, du côté de l'Ardoise entre autres, mais aussi de Marcoule où une énorme et étrange boule métallique paraissait suspendue entre ciel et Cèze... Il croisa un horrible carrosse qui roulait sans chevaux ; puis un autre ; les voitures du Diable ralentissaient, et repartaient aussitôt, sur un regard inquiet du cocher ! Le chien roux ne semblait pas vraiment troublé ; le bouscatier maîtrisa la panique qui le gagnait ; plus il approchait du village, plus il faisait sensation, avec ses sabots, ses vêtements loqueteux, son ample chapeau de feutre qui le protégeait de la pluie comme du soleil ; les êtres bizarrement vêtus le désignaient du doigt ; on riait ; certains se précipitaient sur les enfants pour les emmener cacher bien vite. Quel géant extraordinaire avait bien pu nettoyer les rues du fumier et des immondices de toutes sortes qui empuantissaient l'atmosphère du village ? Qu'étaient devenus les porcs et la volaille qui s'ébattaient d'ordinaire librement sur la voix publique ? Enfin il parvint à l'oustal (à la maison) ! C'était son chez-lui, sans l'être vraiment ; il regarda le toit neuf de la maison, la grille ouvragée de la courette, la porte vitrée de l'entrée, les volets et les boiseries des fenêtres peints de frais. Il voulait par-dessus tout se dérober aux regards qui l'indisposaient ; l'oustal lui donnerait peut-être le sentiment de sécurité qui lui manquait dramatiquement ; il poussa la grille ouvragée, il passa la porte vitrée de l'entrée et IL SE VIT ! C'était bien LUI, sans l'être vraiment ; l'autre LUI était assis, dans un fauteuil plus beau et plus confortable que celui d'un aristocrate ou d'un bourgeois aisé ; tout aussi bizarrement vêtu que les gens de la rue, soigneusement peigné, IL regardait une boite magique où se battaient à coups d'étranges pistolets de bien surprenants monstres : tantôt réduits à la taille du poing, tantôt coupés par le travers du corps ! L'autre LUI sursauta, il se leva, il s'avança vers Guilhem, et il lui parla une langue que le bouscatier reconnut : c'était du FRANÇAIS, tel qu'en parlaient à l'auberge certains marchands se rendant ou revenant de la foire de Beaucaire.
- Te comprende pas ; siàu lo Guilhem Bordiguèt, e siàu aqui en çò de ieu, lui répondit-il !
- JE suis Guillaume Bourdiguet, répondit l'autre LUI, et VOUS êtes ici chez moi ! ”
IL saisit une boite noire, munie de deux oreilles et d'un oeil gigantesque ; IL en arracha le sommet tout en manipulant l'oeil, et IL parla longuement dans une des oreilles. Peu après, un homme courtaud à cheveux blancs se présenta : “ Siàu lo Ramon Fabre, e parle la lenga d'Òc. ” (Je suis Raymond fabre, et je parle occitan) Alors débuta un étrange dialogue, où le monsieur chenu expliquait ce qu'était ce temps-ci, quand Guilhem racontait ce qu'était ce Laudun-là, avec tant de détails que ses interlocuteurs étaient troublés. Le Bourdiguet de ce temps-ci parla enfin ; le Raymond Fabre traduisit : le jeune homme disait que pour la tradition orale le grand-père du grand-père du grand-père de son grand-père avait un jour disparu, après que l'on eut trouvé le seigneur mort non loin de l'endroit où l'ancêtre bouscatier faisait du bois ; depuis chaque premier né de chaque génération s'appelait Guilhem, ou Guillaume ! Le silence durait ! Ils réfléchissaient, chacun quant à soi ; peu à peu, le doute s'insinuait en eux. Ce n'était pas désagréable ; ils rêvaient !
Vinrent les gendarmes, ceux de ce temps-ci, bien sûr, alertés par quelque voisin ; ils demandèrent à Guilhem papiers, adresse ; ils hochèrent la tête avec application quand le Raymond Fabre leur eut traduit la réponse. Les gendarmes pensaient transporter le nouveau venu à Uzès ; il s'y trouvait un hôpital spécialisé pour des cas semblables, le Mas Careiron comme ils l’appelaient ; le vagabond devait les suivre ! Le monsieur chenu et l'autre LUI se regardèrent ; ils regardèrent Guilhem, puis la petite porte qui donnait sur le jardinet ; ils se comprirent ; les deux de ce temps-ci se levèrent et, un bref instant, dérobèrent celui de ce temps-là au regard des gendarmes ; quand ils se rassirent, le Bourdiguet d'un autre temps et le chien roux avaient disparu ! Retrouvèrent-ils le chemin du royaume de la cabre d'or ? L'homme trouva-t-il en lui assez de larmes pour qu'elle apparût une autre fois ? Nul ne le sait, et jamais personne ne les revit !